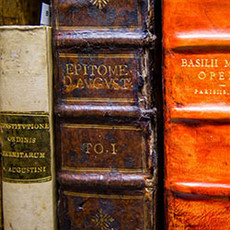Rencontre avec Marylène Patou-Mathis, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS
La manifestation la Science se livre se déroule du 1er au 15 février.
Sur le thème « Femmes et Sciences » la manifestation départementale met à l’honneur les femmes investies dans la recherche, les technologies et l’innovation et promeut les carrières scientifiques. Une centaine d’événements gratuits sont prévus, dont une conférence de Marylène Patou-Mathis, samedi 1er février, à la médiathèque Anne-Fontaine d’Antony (15 h, sans réservation). HDS , le magazine du Département a rencontré lapréhistorienne et directrice de recherche au CNRS.


Préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, Marylène Patou-Mathis, à partir de l’analyse des idées reçues et des dernières découvertes de sa discipline, entreprend de poser les bases d’une autre histoire de l’humanité.
HDS : À quand remonte votre vocation de scientifique et de préhistorienne ?
MPM : Cela a toujours été lié à des questionnements. Enfant, en Seine-et-Marne, je passais beaucoup de temps dans les champs avec ma grand-mère où il nous arrivait de trouver des fossiles marins. Jeune, j’ai aussi assisté à un chantier de fouilles en Dordogne. Ces vestiges me faisaient comprendre que d’autres mondes avaient existé, et ces mondes perdus me passionnaient.
Avez-vous voulu déconstruire les biais sur la femme préhistorique parce que vous êtes une femme ?
C’est compliqué à dire. Dans mes ouvrages, en tout cas, il y a une recherche sur les origines et les présupposés. En travaillant sur les Néandertaliens (dont Marylène Patou-Mathis est une spécialiste reconnue, Ndlr), j’ai pris conscience qu’ils étaient victimes d’un « délit de sale gueule », puisque non seulement on hiérarchisait les espèces mais qu’on infériorisait aussi la femme. Et que c’était la même chose avec les animaux, parce que tout se tient. Sans a priori d’aucune sorte, mon propos est de rendre aux femmes leur juste place dans l’évolution.
Existe-t-il vraiment une « invisibilité des femmes » dès l’époque préhistorique ?
Oui, dans la mesure où les préjugés sur cette période sont ancrés dans les esprits. Dans l’imaginaire collectif, les hommes préhistoriques arborent des armes et terrassent des bêtes effrayantes alors que les femmes sont faibles et oisives. On se demande à quoi elles servent si ce n’est à « balayer la grotte »...
Les origines de cette vision remonteraient à la fondation de votre discipline…
La préhistoire s’est constituée au milieu du XIXe, après 1859, puisqu’il faut attendre Darwin. Elle est alors faite par des médecins, des instituteurs et des ecclésiastiques. Évidemment, la société patriarchale de l’Europe occidentale est leur modèle et ils calquent sur les sociétés anciennes la vision qu’ils ont de leur époque. C’est aussi l’ère de l’anthropologie physique, qui détermine une hiérarchie des êtres selon des mesures telles que la taille du crâne : celui de la femme est plus petit donc elle est moins intelligente. Ces préjugés ont pris la suite des croyances religieuses et les femmes sont devenues inférieures par nature.
Or, rien ne vient, selon vous, conforter l’hypothèse d’un patriarcat issu du fond des âges…
Prenons un outil comme le biface : on peut établir la chaîne opératoire, la matière première, la période et même ce à quoi il a servi. Mais montrer qui l’a taillé ? Tout comme il est impossible de se prononcer pour les gravures et peintures rupestres qui, soit dit en passant, donnent une place prépondérante à la représentation des femmes. Pendant deux cents ans, on a dit que des hommes avaient effectué ces gestes, pourquoi pas des femmes ? En science, l’absence de preuve n'est pas la preuve de l’absence ! Il y a bien d’autres exemples. Au milieu du XXe siècle,l’ethnologie comparée a transposé à la préhistoire les comportements des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs : l’homme à la chasse, la femme à la cueillette. Penser que ces sociétés reflètent la préhistoire n’a selon moi aucun sens. Cela impliquerait que ces peuples-là n’aient pas d’histoire, alors que les structures sociales et les cosmogonies se modifient au cours du temps.
En quoi les progrès scientifiques amènent-ils à reconsidérer les sociétés du Paléolithique supérieur ?
De nombreuses sépultures ont pu être réexaminées à la lumière de l’analyse ADN et des progrès de l’anthropologie. Il a été montré qu’on n’enterrait pas plus les hommes que les femmes et qu’il n’y avait pas de différences dans le mobilier funéraire, ou que certaines femmes étaient plus robustes que l’on ne l’imaginait. Pourquoi ne pas envisager un système social plus équilibré, basé sur la compétence, qui n’a ni âge ni sexe comme chez les San où j’ai vécu (les Bushmen du Kalahari, au Botswana, Ndlr) ? D’autant que dans les sociétés matrilinéaires, on ne voit généralement pas de domination de la femme par l’homme.
Selon vous, la façon dont sont accueillies ces découvertes n’est pas exempte de « mauvaise foi »…
L’attitude de certains collègues masculins sur la chasse et la guerre prête à sourire. On s’est rendu compte récemment que des sépultures de chasseurs-cueilleurs contenant des armes de chasse, il y a 9 000 ans, appartenaient à des femmes. L’argument, cette fois, est que l’on n’enterre pas forcément un défunt avec les objets de sa fonction. Mais pourquoi n’entend-on pas cela quand ce sont des hommes ?
Les jeunes filles sont moins nombreuses à envisager une carrière scientifique. Que leur conseilleriez-vous ?
Nous ne sommes pas déterminés pour telle ou telle activité, mis à part la reproduction évidemment. D’une jeune enfant, vous pouvez faire une guerrière ou une brodeuse ! Je suis arrivée à l’archéologie par des études de géologie, or je n’étais pas programmée pour ça, et je ne venais pas d’un milieu favorisé. On persiste aussi, hélas, à penser que les sciences dures sont plus difficiles que les sciences humaines ou les sciences du vivant. Et cela pose de gros soucis de recrutement pour l’avenir...
Propos recueillis par Pauline Vinatier pour HDS, le magazine du Département
L’homme préhistorique est aussi une femme, Allary Éditions, 2018.