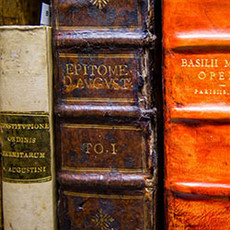Des impressionnistes de l’île de la Jatte à la Vallée-aux-Loups qui abrite la Maison de Chateaubriand en passant par les broderies de buis conçus par Le Nôtre au Domaine de Sceaux et le jardin-musée Albert-Kahn, nature et culture tissent les Hauts-de-Seine, hier comme aujourd’hui. « Prolongeant ce dialogue historique que nous nous attachons à perpétuer et à enrichir, le Département fait de la nature et de la culture deux piliers majeurs de la qualité de vie des Altoséquanais. C’est tout le sens de notre Agenda 2030 pour le développement durable, a expliqué le président Georges Siffredi en introduction, rappelant la politique de végétalisation des cours des collèges, la création de nouveaux parcs ou la grande trame éco-paysagère pour relier parcs et forêts. À l’heure actuelle, la nature en ville est d’autant plus stratégique : c’est une force de résilience.
Un ancrage territorial du patrimoine


Elise de Blanzy, directrice de la culture au Département, et Éric Goulouzelle, directeur des parcs, paysages et de l’environnement,ont ouvert les débats. Elise de Blanzy a souligné les nécessaires convergences entre la préservation de notre environnement naturel et culturel et l’ancrage territorial de notre patrimoine, citant le philosophe Bruno Latour : « Défendre la nature : on baille. Défendre le territoire : on bouge ! ». Miroir des besoins croissants des citoyens, la fréquentation des sites du Département a explosé après le Covid : 725 000 visiteurs en 2022, avec de nombreux événements culturels et les parcs en locomotives.
Initiateur du colloque « Osons les grands parcs », Éric Goulouzelle, paysagiste de formation, a exposé les dilemmes du gestionnaire de parcs soumis à des injonctions parfois contradictoires comme entretenir des broderies de buis avec la menace de la pyrale ou replanter des essences d’arbres identiques, taillés en rideau, emblématiques de certaines avenues historiques, à l’heure de la biodiversité. Un grand écart entre récits historiques et exigences écologiques à l’aune du réchauffement climatique.
« L’urgence est de renaturer »


Pour Sébastien Maire, délégué général de l’association France Ville Durable, expert en résilience territoriale et transition écologique, « Le premier pilier, c’est la sobriété : le “développement durable” est un oxymore. » Son credo : « Passer du durable au régénératif ». Il a témoigné des obstacles rencontrés quand il a initié le projet de renaturation des cours d’écoles de Paris pour créer des îlots de fraîcheur affrontant des parents qui refusaient que leurs enfants se salissent avec un sol sans bitume.
« L’enjeu, c’est l’habitabilité de la planète, six limites planétaires sur neuf sont déjà dépassées, dont le cycle de l’eau, a-t-il rappelé, prônant l’arrêt vital de l’artificialisation des sols. L’eau est un pilier du vivant. L’urgence est de renaturer nos campagnes et de restaurer les sols : des matrices qui abritent 60 % de la vie sur Terre. Le sol absorbe les pluies, rafraîchit l’air, dépollue l’eau, capte le carbone, nourrit les plantes, régule l’oxygène et le CO2…Tout est interconnecté, C’est une logique systémique. » Une gageure pour nos esprits cartésiens et nos organisations en silos.
Artiste plasticienne, Florence le Meaux est ensuite venue présenter son travail avec des éléments naturels, utilisant notamment le papier comme une peau pour envelopper des arbres, créant des sculptures empreintes, une sorte de cartographie du vivant. Avec « Capter l’idée du vent », elle produit entre autres des gravures monotypes, inspirée par le célèbre paysagiste Gilles Clément et son Éloge des vagabondes.
« Créer des espaces de guérison »


Géographe, formateur et consultant, Éric Julien, spécialiste des peuples autochtones de Colombie - les Kogis notamment - a, lui, fait connaître l’étendue de leur savoir scientifique, par essence holistique, leur culture et leur vie en pleine nature ne faisant qu’une. « Pourquoi massacrons-nous la vie avec une telle efficacité ? », a-t-il interrogé. Il faut réconcilier le cercle et le carré. »
Il appelle à une résilience posée sur deux principes : le premier serait l’amélioration de l’existant, par exemple en plantant en effet des arbres dans les cours d’écoles, le second étant de changer de regard et de« créer des espaces de guérison » : « Quels principes permettent de créer la vie ? Les parcs sont-ils une réponse au besoin de nature en ville ? Faut-il “parquer” la nature ? Avant d’aménager, pourquoi ne pas s’intéresser d’abord à l’histoire du vivant du territoire, revenir aux sources, dialoguer avec les éléments de nature et inventer un nouveau récit ? ».
« L’homme n’est qu’un être parmi d’autres »


Ethnologue, Florence Brunois-Pasina, chercheure au laboratoire d’anthropologie du CNRS, a partagé son expérience de vie auprès d’un peuple semi-nomade, les Kasuas de Papouasie Nouvelle-Guinée, vivant en pleine forêt équatoriale. Elle décrit ainsi leur représentation du vivant : « Ils ne vivent pas dans la nature, ils habitent un cosmos. Ils ont une connaissance “expérientielle” de l’écologie, basée sur une culture de l’attention. La forêt est un être englobant, interactif, où l’homme n’est qu’un être parmi d’autres, en relation avec les autres. Leur monde n’est pas catégorique, le lien est au centre et ils fonctionnent en collectifs. »
En conclusion, les intervenants ont souligné notre vulnérabilité - « Ce n’est pas l’écologie qui est punitive, mais les catastrophes climatiques en cours » - et ont appelé à retrouver la mémoire du vivant et créer un récit porteur d’enthousiasme.
- Écouter l’entretien en podcast sur le site des EAK, eak.hauts-de-seine.
- À lire : Par-delà nature et culture, par l’anthropologue Philippe Descola. Gallimard, 2005.